PRIVILÈGES ET BREVETS
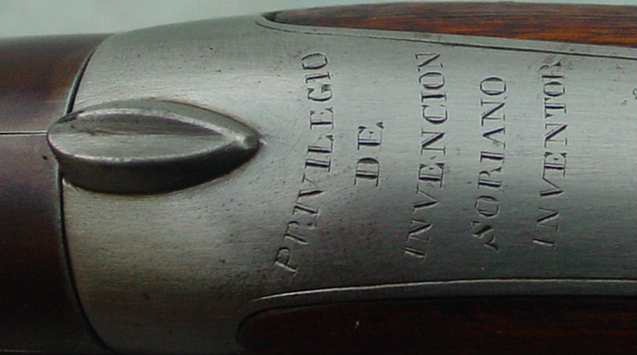



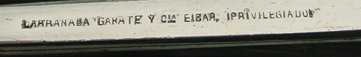
La
première mesure concrète visant à protéger les inventeurs fut adoptée en
Espagne par Charles III qui, par un décret royal du 29 novembre 1776,
accorda des “titres de privilège” à ceux qui inventaient ou
introduisaient des machines ou des dispositifs inconnus en Espagne et
dans ses territoires. L’objectif était d’encourager la création de
nouvelles industries, plutôt que de reconnaître la propriété
intellectuelle des inventions. Le “titre de privilège” conférait des
droits d’exploitation exclusifs pour une durée déterminée.
Cette
première mesure, dont j'ignore les résultats hypothétiques dans le
domaine de l'armement portatif, fut suivie de la loi du 2 octobre 1820,
inspirée de la loi française de 1791. Elle reconnaissait le droit de
propriété de l'inventeur sur son œuvre, stipulant dans son premier
article : “Quiconque invente, perfectionne ou introduit une branche
d'activité industrielle a droit à la propriété de celle-ci, pour la
durée et dans les conditions prévues par la présente loi”. Les titres
octroyés étaient définis comme des “certificats d'invention”, mais
l'abrogation de cette loi la même année que son entrée en vigueur rend
son application douteuse.
Par
décret royal du 27 mars 1826, Ferdinand VII reconnut à nouveau la
propriété des inventions par leurs créateurs, tout en renouant avec
l'emploi du terme “privilège” dans les décrets royaux destinés aux
parties intéressées. Ces décrets de “privilège” pouvaient être
“d'invention” si l'invention concernait une nouveauté, ou
“d'introduction” si elle portait sur une invention connue à l'étranger
mais non encore exploitée en Espagne.
Dans
le premier cas, le droit exclusif de fabriquer l'invention pouvait être
demandé pour une durée maximale de quinze ans, tandis que dans le
second, cette durée était réduite à cinq ans.
Ce
décret royal resta en vigueur pendant plus de cinquante ans, intégrant
durant cette période une série de dispositions complémentaires visant à
clarifier les concepts et à établir les exigences. On peut citer, par
exemple, l'Ordonnance royale du 27 juillet 1829, qui précisait que les
“privilèges d'introduction” visaient à protéger les produits fabriqués
localement et non les produits importés, ou encore l'Ordonnance royale
du 11 janvier 1849, qui imposait la démonstration de la mise en œuvre du
privilège “dans un délai d'un an et un jour”. Il est clair que, pour
l'Administration, la préoccupation première n'était pas la perception
des droits de délivrance des décrets royaux – dont le montant, dans le
cas des certificats d'”invention”, augmentait proportionnellement à la
durée demandée –, mais plutôt la fabrication du produit “privilégié” en
Espagne, afin de promouvoir son industrie.
Un
inventeur résidant hors d'Espagne pouvait obtenir un “brevet royal” pour
l'un de ses produits, mais s'il ne parvenait pas à en organiser la
fabrication en Espagne dans le délai imparti, que ce soit en créant une
usine ou en accordant une licence à un fabricant national, il perdait
ses droits. Un inventeur qui n'a pas obtenu de brevet d'invention pour
ses produits ne peut légalement empêcher leur fabrication en Espagne
sans son autorisation, ni empêcher un tiers d'obtenir un brevet de mise
en circulation. Logiquement, la fabrication d'un produit en Espagne sans
dépôt de brevet rend caduque toute tentative ultérieure d'obtention d'un
brevet pour ce produit.
Le
nombre de privilèges demandés durant les cinquante années d'application
du décret royal du 27 mars 1826 s'élevait à 5 009, un chiffre légèrement
supérieur en raison de doublons dans la numérotation de certains
dossiers. Seules six demandes relatives aux armes portatives ou aux
armureries furent déposées entre mars 1826 et avril 1852. Entre avril
1852 et juillet 1878, 128 demandes furent enregistrées : 52 par des
Espagnols et 76 par des inventeurs d'autres nationalités. Seules deux
concernaient les armes blanches.
Avec
la loi sur les brevets du 30 juin 1878, la demande de certificats de
“privilège” prit fin et la demande de titres de “brevet” commença.
Cependant, la terminologie précédente était si profondément ancrée que,
jusqu'à la fin du siècle, les termes “privilège” ou “privilégié”
restèrent dans le langage courant comme synonymes de “brevet” ou
“breveté”.
La
nouvelle loi ne mentionnait que les “brevets d'invention”, introduisant
la notion de “nouveauté absolue”, définie comme “ce qui n'est ni connu,
ni établi, ni pratiqué sur le territoire espagnol ou à l'étranger”. Seul
ce qui remplissait cette condition pouvait être breveté. Toutefois, le
texte précisait ensuite : “la durée des brevets pour tout ce qui n'est
pas une invention propre, ou qui, même inventé, n'est pas nouveau, sera
de cinq ans non renouvelables”. De ce fait, l'existence de “brevets
d'introduction” était de facto autorisée, bien que considérés comme des
brevets d'invention d'une durée de cinq ans.
La
durée des brevets d'invention était fixée à 20 ans non renouvelables,
sous réserve du paiement d'une redevance annuelle progressive, de la
mise en œuvre du brevet sur le territoire espagnol dans un délai de deux
ans, et du maintien de cette production de manière continue ou sans
interruption supérieure à un an et un jour. Dans les deux derniers cas,
une prolongation de six mois pouvait être demandée, sur justification.
Parmi
les autres points d'intérêt figuraient l'intitulé de chaque brevet, qui
stipulait : “Brevet d'invention sans garantie de l'État quant à la
nouveauté, l'adéquation ou l'utilité de l'objet auquel il s'applique”,
et le texte de l'article 52 du titre 9, indiquant que “l'action en
poursuite pour usurpation, prévue et punie par le présent titre, ne peut
être engagée par le ministère public que sur plainte de la partie
lésée”.
L'État n'était pas tenu de vérifier si une demande de brevet pouvait
porter atteinte aux droits d'un autre brevet existant, ni de garantir
que le produit breveté procurerait l'avantage escompté par son
inventeur, ni d'engager des poursuites contre ceux qui ne respectaient
pas les droits conférés par un brevet sans plainte préalable de la
partie s'estimant victime de son usurpation.
Il
devint donc nécessaire de fournir des informations sur les brevets
délivrés. La nouvelle loi instaura ainsi la publication trimestrielle,
dans la Gazette de Madrid, des brevets accordés durant cette période,
“avec une description claire de leur objet”. Cette pratique se
poursuivit jusqu'à l'adhésion de l'Espagne à la Convention
internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à
Paris le 20 mars 1883, qui imposait la publication périodique d'une
liste officielle des brevets délivrés. Cependant, ce n'est qu'en 1886
que fut décrétée la création du Bulletin officiel de la propriété
intellectuelle et industrielle, qui, à partir de 1904, devint
exclusivement le Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
Auparavant, le 16 mai 1902, une nouvelle loi sur les brevets avait été
promulguée, révisant la précédente. Cette nouvelle loi définissait
clairement, sans ambiguïté, les “brevets d'introduction”, destinés aux
produits non exploités nationalement et non couverts par un brevet
espagnol, et les “certificats d'addition”, pouvant être obtenus par le
titulaire d'un brevet d'invention modifiant ou améliorant celui-ci. Un
inventeur ayant breveté un produit hors d'Espagne disposait d'un an pour
déposer une demande de brevet espagnol. Passé ce délai, toute personne
pouvait demander un brevet d'introduction pour son invention en Espagne.
La mise en œuvre de l'invention brevetée devait être démontrée dans un
délai de “moins de trois ans”. Ceux qui ne disposaient pas des moyens de
le faire dans ce délai pouvaient le prolonger en annonçant publiquement
leur volonté d'accorder une licence à toute personne qui en ferait la
demande.
Certains inventeurs étrangers n'avaient aucune intention de s'installer
en Espagne, ni de concéder des licences. Leur objectif, en obtenant des
brevets, était de retarder autant que possible le démarrage d'une
production nationale susceptible de concurrencer leurs fabrications
étrangères.
Un
décret-loi royal du 26 juillet 1920 relatif à la propriété industrielle,
révisé en 1930, a donné naissance au “Statut sur la propriété
industrielle”, qui a servi de base à la législation ultérieure en la
matière.
Juan Luis Calvó – Janvier 2008
Bibliographie:
“Tratado de Derecho Industrial”, H. Baylos Corroza, Madrid 1978
“La
Industria Armera Nacional, 1830 – 1940. Fábricas, Privilegios, Patentes
y Marcas”, Juan L. Calvó, Eibar, 1997